14/06/2010
Nous l'avons déjà dit et répété : nous ne sommes pas assez efficace au niveau du centre de décision Européen ... Mais on en parle de plus en plus
exemple cette intervention parue le 1er juillet 2008
Nous sommes en retard d’une Europe
Vous opposez dans votre livre deux conceptions de l’Europe… |
||
| Pourquoi ? Entre autres, parce que nos hauts fonctionnaires ne sont pas préparés à l’Europe. Ils apprennent à raisonner « européen », au lieu de raisonner français dans un espace européen. Contrairement aux Britanniques, qu’on a grand tort de considérer comme des eurosceptiques et qui ont compris tout le parti qu’ils pouvaient tirer de l’Europe. Ils se sont parfaitement intégrés à la construction européenne et ils en maîtrisent les rouages. Les Français n’ont pas compris comment on défend ses intérêts au niveau européen. Ils en restent à une logique institutionnelle, celle de la diplomatie classique. Or aujourd’hui, pour défendre ses intérêts, il faut passer par le système de l’influence, des lobbies, comme à Washington. Nous avons une méfiance instinctive, voire un certain mépris, à l’égard de ces acteurs non-étatiques ; nous n’arrivons pas à croire que leur action soit déterminante. |
||
| En admettant que les Français comprennent comment défendre
leurs intérêts, encore faudrait-il qu’ils en aient la volonté. Il y a un certain ma l aise, c’est vrai, avec l’idée de défendre les intérêts français au niveau européen, dans la mesure où l’on a estimé que l’idéal européen devait primer à tout prix. Et on finit par considérer que les sacrifices nationaux sont le signe heureux que cet idéal est en train de s’imposer. On se méprend ainsi gravement sur le sens de la construction européenne. Comment les Français espèrent-ils faire prévaloir les intérêts de l’Europe dans le monde, s’ils ne sont pas capables d’y bâtir les réseaux de leur propre influence ? |
||
| Comment fonctionnent les Français ? De deux façons : soit on attend que la norme européenne sorte et on définit une position française, au dernier moment, quand il est trop tard, soit on arrive avec un grand projet qu’on présente à nos partenaires, en espérant qu’il suscite une adhésion générale. Or ce n’est pas comme ça que ça se passe ! La norme européenne se construit très en amont. Elle se construit aussi, comme savent le faire les Britanniques, par le suivi très attentif des législations au sein même des institutions européennes à travers le placement et le suivi des fonctionnaires au sein des institutions. Les Français sont convaincus que pour influencer une institution, il faut être à sa tête : Trichet à la BCE, Strauss-Kahn au FMI, Lamy à l’OMC… Et on se désintéresse des « petits » fonctionnaires. Or ce sont eux qui font tourner la boutique au quotidien et qui élaborent les normes et les directives qui concerneront 450 millions d’Européens ! |
||
| En clair, vous ne trouvez pas très stratégique d’arriver dès
le départ avec un grand projet sur la table, avec lequel on dévoile ses
batteries. Oui, Aujourd’hui, on ne peut plus seulement s’appuyer sur un processus diplomatique qui consiste à dire : j’ai une idée, qui m’aime me suive ! Dans une Europe à 27, il faut à la fois réunir une coalition d’États et faire en sorte que le projet, quand il sort de la commission, soit validé comme étant conforme à l’intérêt européen. Il faut que les Français comprennent qu’avec 27 États membres, le poids de la France est fortement diminué, on ne peut plus s’appuyer sur le seul poids démographique et économique de notre pays. Dans mon livre, je me suis justement attaché à formuler des propositions pour retrouver les voies de notre influence perdue. |
||
| Chez les Anglo-Saxons, il semble qu’il y ait entre le privé
et le public une alliance naturelle. Les passages du public au privé sont importants au Royaume-Uni. En France, seules les grandes entreprises sont bien représentées par les pouvoirs publics. Pas les PME. En résumé, l’osmose entre l’État et le monde économique est meilleure chez les Anglo-Saxons qu’en France. |
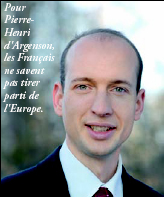
 contact à
contact à